L'écriture, et ses supports, est une invention que l'on peut dater, repérer, interpréter dans ses différentes modalités ; c'est aussi une aventure individuelle, à chaque fois recommencée. Il est intéressant, pour une psychanalyste de penser une confrontation entre des évènements historiques et sociaux et les événements singuliers, auxquels les analysants, qu'ils soient enfants ou adultes, ont affaire dans leur propre histoire : chacun n'est-il pas amené à marcher dans les pas de ceux qui l'ont précédé, et à franchir à nouveau les étapes qui furent celles de l'humanité pour inventer les signes magiques de l'écriture ?
Il y a, en effet, plusieurs scènes, en rapport les unes avec les autres, pour lire et interpréter la naissance de l'écriture :
- la scène de l'histoire de l'origine de l'écriture où il est possible de considérer son évolution, de repérer les moments fondateurs :
- la scène de l'apprentissage individuel : comment les enfants se mettent-ils à écrire, qu'est-ce qui fait écriture pour eux. Les difficultés des apprentissages de la lecture et de l'écriture permettent de dégager des points de butée, et les étapes de cette mise en place.
- l'autre scène (die andere Schauplatz), celle de l'inconscient, du lapsus, du mot d'esprit, de l'oubli et du rêve : que nous apprend-elle puisque nous pouvons dire avec Freud que l'inconscient sait lire ?
Je voudrais prendre le temps de ce travail pour tisser des liens entre l'aventure de l'humanité et l'aventure singulière de la découverte de l'écrit, pour rendre compte de l'appropriation du monde réel par une pensée en acte au moment de l'invention pictographique, et du saut hors de la représentation que nécessite le passage à la combinatoire de l'alphabet.
A chaque fois, pour chaque sujet, le corps y est engagé de par les fonctions du regard, de la voix et de l'oreille. A chaque fois aussi le rapport à l'autre est sollicité : pas d'écriture, pas de lecture sans adresse première à un autre, ni sans investissement de la part de cet autre. La trace, le dessin, la lettre, les conditions de leur inscription témoignent de la subjectivité humaine et de sa mise en place.
Quels sont les événements qui ont permis l'invention de l'écriture, événements historiques et psychiques, et quel est l'événement qui permet son apprentissage pour un sujet ? A partir des repères psychanalytiques, nous pouvons dire que deux événements, historiques mais aussi psychiques président à l'invention de l'écriture :
- tout d'abord, et à propos de l'écriture pictographique puis idéographique, il y a eu, à Sumer, le passage de frontières entre le sumérien et l'akkadien qui a permis un décollement du dessin vers l'écriture, et le passage d'un investissement pulsionnel purement visuel, à un investissement double, de l'œil à l'oreille. Ceci concerne d'ailleurs aussi bien ce qui s'est passé en Mésopotamie, qu'en Egypte, entre 3000 et 1400 av JC.
- ensuite, la question de la représentation s'est trouvée totalement remaniée à partir de l'invention du monothéisme. Ceci aura comme conséquence une coupure, une séparation entre le sacré et la chose qui auparavant supportait ce sacré. Tout le rapport au sens va s'en trouver changé et permettra aussi le surgissement de l'écriture alphabétique. Nous reprendrons ceci plus loin.
Ainsi s'inventent deux grands types d'écriture, qui se supportent de positions subjectives très différentes : l'une basée sur l'usage de signes et de symboles, l'autre sur des lettres séparées de leur support symbolique. Une lente et longue évolution, et un événement, le monothéisme, font passer de l'une à l'autre les pays du bassin méditerranéen.
Ecrire.
L'homme a d'abord tracé des signes, des encoches dans le bois, des incisions dans la pierre, des peintures … bref autant de marques et de modalités qui sont des repères ou des conjurations de l'absence.
Le dessin garde une mémoire des choses et des êtres — il porte l'empreinte de notre corps — le dessin représente, crée les formes des choses en les nouant au geste.
Ecrire, c'est dessiner. Mais dessiner n'est pas encore écrire — écrire c'est ajouter de la parole au dessin — car le dessin ne permet pas de tout montrer ; il se heurte à l'irreprésentable. Comment dire avec un dessin "vouloir", "se souvenir", "demain"…? L'écriture et son histoire commence avec le besoin de figurer ce qui n'a ni forme ni visage. Elle naît de la magie de la rencontre du pictogramme avec la valeur phonétique. Elle apparaît ainsi avec l'invention du rébus, étape décisive où le son chasse l'image à l'intérieur du signe.
Là où l'image se "tait", l'écriture introduit la possibilité de dire ce qu'on ne peut représenter au sens de représentation de choses ; elle nomme.
Sumer et Akkad
L'écriture cunéiforme est la plus ancienne que nous connaissons. Elle est inventée par les Sumériens qui vivent en Mésopotamie entre IVème et IIIème Millénaire. Les Sumériens ne sont pas originaires de Mésopotamie — la question de leur provenance reste ouverte — et leur langue n'appartient pas au groupe des langues indo-européennes ni au groupe des langues sémitiques. Dans la langue sumérienne, la plupart des mots semblent avoir été monosyllabiques avec une grande quantité d'homophones. Par exemple "du" peut dire : pied donc aller, et aussi construire, heurter, libérer ; "ti" signifie la flèche mais aussi la vie. La syntaxe est marquée par des mots invariables, préfixes, suffixes, affixes ajoutés aux mots essentiels eux aussi invariables.
En Mésopotamie, entre Tigre et Euphrate vit une autre population, sémitique, appelée habituellement akkadienne. Leurs descendants peuplent encore une partie du Proche-Orient actuel. Ils viennent du nord et de l'est du désert arabo-syriaque. La langue des sémites est encore parlée de nos jours : l'hébreu, l'arabe, l'araméen en dérivent. C'est une langue qui marque les rapports grammaticaux par des déclinaisons et des conjugaisons. Les mots sont en grande majorité polysyllabiques.
Culturellement et politiquement les deux communautés ont vécu en bonne entente. Les Sumériens ont peu à peu été dépassés et absorbés par le nombre des sémites. Mais ce sont eux qui ont inventé l'écriture.
Les Sumériens utilisaient différents pictogrammes qui sont des dessins gravés sur la pierre ou sur des plaques d'argile, représentant des objets facilement reconnaissables. Il y avait aussi des symboles servant au comptage des troupeaux notamment. L'évolution des signes a eu lieu en partie à cause d'une nouvelle manière d'inscrire les signes, à l'aide d'un roseau taillé en biseau dont la pointe enfoncée dans l'argile fraîche donna cette forme particulière appelée cunéiforme. Ceci a eu comme conséquence une stylisation de plus en plus grande de ces signes. Le réalisme primitif des dessins se trouva aboli, et peu à peu la forme s'est détachée de la signification.
Apparaît donc un premier arbitraire, relatif, car probablement la mémoire jouait un grand rôle dans la connaissance des signes. Cependant nous assistons, avec l'écriture cunéiforme au passage du pictogramme à l'idéogramme.
Une autre différence entre pictogramme et idéogramme, sémantique cette fois, est que le pictogramme renvoie à une réalité matérielle alors que l'idéogramme renvoie virtuellement à toute une constellation sémantique autour de cet objet. On parle cependant d'écriture pictographique tant qu'il s'agit d'une écriture de choses, et non de mots, et que les caractères n'ont rien à faire avec la phonétique. C'est donc une écriture qui reste visuelle, avec un seul lieu d'investissement pulsionnel qui a affaire avec le beau.
Une écriture de choses implique que le signifié des pictogrammes est toujours une chose, telle qu'elle est pensée, représentée. On a donc affaire à des représentations de choses. Les limites de cette écriture est l'impossibilité de marquer les relations entre les choses représentées, c'est-à-dire la syntaxe, ce qui a pour conséquence une écriture illisible au sens de rendre compte des relations entre les choses, c'est-à-dire de l'abstraction et de l'irreprésentable. Voilà pourquoi, comme le souligne Bottéro1 dans son ouvrage, l'écriture cunéiforme n'était et ne pouvait être qu'un aide-mémoire, dans son premier stade pictographique.
Un pas de plus a été fait avec le phonétisme. Du fait de nombreuses homophonies dans la langue sumérienne un signe a pu être utilisé non pas pour la chose représentée mais pour évoquer un autre objet dont le nom était phonétiquement identique. Utiliser le pictogramme de la flèche "ti" pour désigner autre chose qui se disait aussi "ti" ,la vie, c'est arrêter la relation première de ce signe à un objet, pour l'articuler à un phonème, c'est-à-dire à quelque chose appartenant à la seule langue parlée.
A ce moment-là, on a une révolution du système graphique — et on passe d'une écriture de choses à une écriture de mots. Ce système ne transmet plus seulement la pensée via le graphisme et le visuel, mais par la parole et la langue.
Deux conséquences à cela : il est nécessaire de connaître la langue de celui qui écrit pour comprendre le message ; cela permet d'inscrire ce qu'exprime le langage parlé. Le système graphique n'est plus réservé à commémorer, mais il peut informer, instruire, inventer, écrire du nouveau.
Et pourtant cette invention de l'utilisation phonétique n'a pas révolutionné l'écriture. La pictographie comme telle n'a pas été éliminée. Le phonétisme n'a été considéré que comme processus complémentaire.
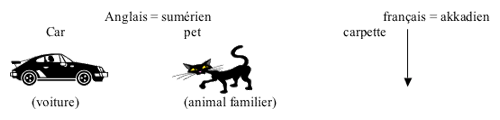
Ce qui permettra l'invention de l'écriture proprement dite, c'est l'existence, à côté du sumérien, de la langue sémitique. Il fallait bien, cette langue akkadienne, la transcrire, du fait des rapports économiques, culturels, politiques des deux peuples.
Cette seconde langue oblige l'écriture à passer d'une écriture purement visuelle à une écriture qui sera articulée, oralisée. Gérard Pommier2 parle du passage d'une frontière entre ces deux langues, passage qui est la condition nécessaire de cette invention. Je pense qu'on peut parler aussi du passage d'un investissement pulsionnel à un autre : de l'œil à l'oreille.
Cette écriture fonctionnera désormais en akkadien comme un rébus mais dont les éléments pictographiques et phonographiques pourraient appartenir à l'autre langue. Comme si on écrivait un rébus qui s'entendrait en français avec des dessins qui se lisent en anglais par exemple.
C'est le passage de cette frontière de Sumer à Akkad , et aussi de l'œil à l'oreille qui a permis ce premier pas, de l'aide—mémoire à l'écriture.
Gardons cependant présent à l'esprit que cette écriture et son statut sont foncièrement différent de la nôtre.
Par cette écriture, un pictogramme est devenu un idéogramme renvoyant à un réseau de sens multiples qui, d'une certaine manière, sont déjà contenus dans le mot évoqué par le pictogramme, du fait de la structure même de cette langue, qui comporte de nombreux mots monosyllabiques, et du fait de nombreux homonymes. Par exemple le pictogramme qui représente le pied peut renvoyer à pied, marche, station debout, l'implantation solide sur ses bases, le transport, le commerce, etc… Le pictogramme "étoile" renvoie au ciel, aux dieux, à ce qui est en haut, supérieur, souverain, etc…
Chaque caractère est donc enrichi d'une constellation de significations, actuelles ou virtuelles, exploitées ou exploitables, si bien que la possibilité de concentrer en un seul et même signe tout un pan du réel, tout un réseau de significations est demeuré une caractéristique de cette écriture. Jamais nous dit Bottero3, les lettrés n'ont oublié cette capacité foncière et originelle de leur écriture.
Il est possible ainsi de soutenir que la figure écrite, l'idéogramme, n'est pas détachée de la chose qu'elle est censée évoquer, de la même manière que le nom lui-même n'est pas totalement détachée de l'être de la chose. Dans un poème adressé au dieu Marduk parmi les cinquante noms qui lui sont conférés, il lui est donné celui d'Asari. Par ce nom Marduk était défini comme "donateur de l'agriculture, fondateur du quadrillage (irrigation) des champs, créateur des céréales et du chanvre, producteur de toute verdure."
Tout ceci est contenu dans le nom d'Asari. Le lettré sumérien le décompose en A-sa-ri où "a" évoque le quadrillage hydrographique des champs, "sar" la production, la verdure, l'agriculture, les céréales, le chanvre et "ri" donner, fonder.
Toutes ces notions composent le nom. Elles en font partie intégrale. Le nom n'est pas un épiphénomène, un accident extrinsèque de la chose, une conjonction arbitraire d'une relation de signification avec un ensemble de phonèmes. Le nom, pour les sumériens a sa source, non pas dans celui qui nomme mais dans la chose nommée. Il en est une émanation inséparable. Recevoir un nom et exister, selon les qualités prescrites par le nom, c'était tout un.
Façon de dire que chez les Mésopotamiens, le réel colle aux semelles des mots. L'écriture est une écriture de choses, et elle demeure concrète et réaliste. Ce qui est écrit est moins le nom prononcé de la chose que la chose elle-même, munie d'un nom inséparable d'elle. Et ce nom constitue une donnée matérielle de substance, dont chaque parcelle contient toutes les vertus de l'ensemble. En ceci l'écriture comporte une part de sacré et de magique.
Il est remarquable que, même une fois le système phonétique mis au point du fait de l'utilisation akkadienne de l'écriture, celle-ci ne devint jamais une écriture purement syllabique. Comment se fait-il que le principe du phonétisme, tellement plus pratique, ne fut pas poussé jusqu'à ses dernières conséquences dès qu'il fut découvert ?
Tout semble s'être passé comme si cette écriture avait mis en place un réel organisé d'une certaine manière, avec ses coordonnées symboliques et sacrées et un rapport codifié à l'écrit. Comment le lettré sumérien, le scribe égyptien oseront-ils tenir leur roseau ou leur stylet sinon en plaçant dans l'écriture elle-même les dieux qui ordonnent le réel. La question de la représentation ne procède donc pas de la religion. C'est elle au contraire qui est à sa source, à son principe. L'homme de Sumer, en se confrontant à la question du réel invente et l'écriture et les dieux. Lorsque le nom écrit est conçu comme une émanation de la chose, lorsque la source de la représentation de choses se trouve dans les choses elles-mêmes, cela établit un rapport au monde de l'ordre d'une continuité basée sur le sens. L'écriture pictographique et idéographique, écriture représentative, favorise le foisonnement du sens. Basée sur le visuel elle permet d'embrasser d'un seul coup d'œil une foule de traits, contrairement à l'écriture alphabétique qui elle, combine le sonore et la lettre, dans une saisie du langage et non plus de l'idée.
Aleph, bet, etc…
Les écritures non alphabétiques, dites pictographiques ou idéographiques sont nés d'abord en Mésopotamie et en Egypte, mais aussi en Chine, en Amérique Centrale, en Crète.
Il semble que l'écriture alphabétique, elle, ait une origine unique au deuxième millénaire dans une région où ne se parlaient que des langues sémitiques entre les deux grandes régions Egypte et Mésopotamie.
Le premier alphabet dont nous avons une trace historique certaine est l'alphabet ougaritique qui apparaît au XIVème siècle av JC. Ce sont les fouilles de Ras-Shamra sur la côte Syrienne qui l'ont mis à jour. Cette langue ougarite appartient au groupe des langues sémantiques cananéen et son apparence est cunéiforme. Cependant si l'instrument est le même, les signes n'ont rien à voir: il s'agit de signes dont le nombre est de trente. Mais ce n'est pas la forme de ces lettres qui va se transmettre à nos alphabets modernes.
Car à la même époque naît une autre expérience alphabétique, issue de l'autre grand système d'écriture : le hiéroglyphe égyptien. Cet alphabet est découvert dans le désert du Mont Sinaï d'où son nom d'alphabet protosinaïtique.
Cet alphabet note une écriture sémitique dont on peut penser que c'est celle des ouvriers esclaves hébreux de l'Egypte de l'époque correspondante à la fin de l'esclavage des Hébreux et de la sortie d'Egypte ainsi qu'à l'époque de Moïse et au don de la loi sur le mont Sinaï. L'ordre des lettres peut être reconstitué et il est très proche de l'alphabet ougaritique. C'est la connaissance de l'hébreu qui a permis de déchiffrer cet alphabet.
L'hypothèse, qui dérive de la façon dont les premières notations phonétiques ont été inventées, est que le son qu'indique chaque image correspond à la sonorité initiale des noms des objets représentés. Comme le rappelle Marc Alain Ouaknin4, le dessin d'une maison, qui se dit en hébreu bayit note le son "b" ; le dessin d'une bosse de chameau qui se dit gamal, donne la sonorité "g" etc… Ces noms de lettres donneront en grec bêta, gama, etc… C'était déjà la manière de noter les phonèmes en sumero-akkadien ou en egyptien où seule la première syllabe de l'objet représenté devait être lue.
Mais maintenant, si la lettre garde le nom de l'objet, ce n'est plus que la sonorité consonantique qui est utilisée dans la lecture de la lettre. La lettre en tant que lettre différente de toutes les autres est née, en tant qu'élément dissociable des objets, choses représentées (dans le registre visuel), mais aussi dissociable des autres lettres (dans le registre sonore). La lettre dans son double système est l'ultime étape de la séparation entre représentation et signe. De l'idéogramme à la lettre, c'est la mise en place d'un processus mental qui aboutit au refoulement de l'image. Cet effacement produit la lettre dans sa sonorité et dans sa double articulation son/signifié. La représentation s'articule désormais à la lettre, il s'agit maintenant d'une représentation de mots.
Notons la contemporanéité de l'invention de l'alphabet et de l'apparition du monothéisme dans son événement fondateur : la révélation et le don de la loi au mont Sinaï.
Des dieux, un Dieu
Freud, dans L'homme Moïse et le monothéisme évoque la question des noms de Dieu, et de l'interdit porté sur ce nom. Cela nous ramène à la dimension du sacré dans l'écriture. Mettre en correspondance les cinquante noms du dieu Marduk chez les Sumériens, et l'interdiction de nommer Dieu permet de rendre compte du passage du totem au Nom, imprononçable de Dieu, et de saisir le refoulement qui s'est opéré dans ce passage. Les cinquante noms de Marduk lui confèrent toute la puissance de la terre, de par l'évocation, contenue dans chaque mot-syllabe, l'écriture d'un de ses noms convoquait de façon réelle la chose nommée. L'écriture, en tant qu'écriture de choses, demeure réaliste et concrète. Ce qui est écrit est autant le nom prononcé de la chose que la chose elle-même. Le nom est une substance. Ne pourrions-nous pas considérer que ce nom, dont la source est dans la chose nommée, est tout proche, dans son usage, du totem ? C'est une autre façon de dire que l'homme, en se confrontant au réel, invente pour s'en protéger, pour l'humaniser, et l'écriture et les dieux.
Cette conception magique totémique organise une religion contra-phobique : autant de totems que d'entités maléfiques. La phobie délimite un espace religieux totémique. G. Pommier5 nous fait remarquer que le passage du polythéisme au monothéisme évoque le trajet qu'accomplit un enfant lorsqu'il abandonne le territoire des phobies pour entrer dans celui de la névrose. Le refoulement secondaire sera alors totalement accompli au sens où la multiplicité des noms du père, attachés aux phobies, une par une, se noue à un seul nom de ce fait infigurable et imprononçable.
Le "petit Hans" présenté par Freud dans Les cinq psychanalyses et longuement commenté par Lacan dans son séminaire La relation d'objet tenu en 1956-57, en est une illustration clinique tout à fait exemplaire.
Ce Dieu unique, du fait de son unicité même opère une coupure entre réel et représentation. A partir de là, la représentation du réel n'est plus en continuité, elle a besoin d'un support, d'un mot fait de lettres qui ont perdu le caractère réel de la chose et Dieu ne peut plus être représenté ni être contenu dans son nom : c'est l'interdit de la représentation et le nom imprononçable.
Ce Dieu unique est devenu, pour les hommes, comptable des avatars de la vie humaine. Jusqu'alors, il y avait autant de dieux ou de totems que d'angoisses, c'est-à-dire aussi que de "lieux pulsionnels" : la bouche, et toutes les angoisses de dévoration, la zone anale, et tous les fantasmes ordonnés autour de l'agressivité, de la maîtrise, de la motricité, l'œil et les images monstrueuses qu'il peut créer, etc…
Le principe unificateur regroupe tous les dieux et leurs fonctions protectrices ou interdictrices sous le nom d'un seul. Ce même principe unificateur ordonne les pulsions autour d'une fonction que Freud nommera la fonction phallique. C'est le sexuel qui rassemble et transforme en une seule libido les pulsion partielles et leurs lieux d'inscription dans le corps.
Si l'on admet avec Freud le primat du phallus, ce qu'il démontre une fois de plus dans la troisième partie de L'homme Moïse et le monothéisme notamment dans le chapitre qu'il nomme L'analogie, alors cet élément unificateur et ordonnateur du refoulement est précisément le phallus : c'est lui qui organise et exige en quelque sorte le refoulement de toutes les pulsions, dont on comprend du coup que Freud les nomme partielles. Qu'il s'agisse de la pulsion orale, anale, scopique, ou invocante, chacune sera prise dans cette phallicisation, cette "unification" et dans la coupure de son lieu d'origine. C'est une autre manière de rendre compte de la dimension d'objet perdu, de ces objets pulsionnels à partir du moment où ils sont pris dans l'économie phallique, c'est-à-dire dans l'économie du refoulement. Cette opération de rassemblement, et de transformation est supportée par la fonction paternelle. Le père, en psychanalyse, est d'abord u signifiant, un Nom, nécessitant d'être endossé par un homme qui en supporte la fonction.
La lettre, détachée de la représentation réelle à la chose, est née à ce moment structural. Et la subjectivité des hommes en a été totalement remaniée. On peut affirmer notamment que la fonction paternelle est issue directement des trois monothéismes qui font notre culture et notre lien social, et des modalités de représentation.
Cette question du passage du pluriel des dieux et des pulsion partielles au singulier d'un Dieu le père et de l'ordre sexué phallique se retrouve dans les sortes d'ecrits auxquels nous sommes confrontés, et notamment au moment des apprentissages.
Quelque chose de la magie de l'invention idéographique est là dans les premiers dessins. Le réalisme symbolique des petits nous émerveille souvent. En dessinant, l'enfant se fait naître d'une deuxième naissance qui noue son geste aux paroles qu'il entend sur lui, sur le monde, et aux affects qu'il peut éprouver en lui ou dans on entourage. Il s'agit de "réaliser" ce qui, dans ce qu'il vit, pousse à se représenter, fait butée ou énigme.
Au moment des apprentissages scolaires de l'écriture et de la lecture, s'opère un retournement, un changement de perspective qui l'amène à refouler le plus souvent ce type premier d'expression, au profit de l'usage de la lettre, et du plaisir du texte. Ce changement de perspective est un effet du principe ordonnateur du refoulement que nous évoquions plus haut.
Cette opération subjective est nécessaire car elle noue et subvertit à la fois les premières représentations à l'appropriation de l'usage de la lettre. C'est ce nouage qui assure la jouissance du texte du sujet, côté écriture et côté lecture. Cette jouissance peut être plaisir ou douleur, du fait qu'elle s'origine et s'ancre dans les émotions primordiales et dans l'histoire familiale qui le précède. Elle est aussi, tout simplement, le bon usage de cette lettre. Toutes sortes d'avatars, de difficultés, de symptômes, vont se manifester lorsque le changement de perspective est insuffisamment réussi, et ne libère pas assez la lettre du sens.
Romain écrit son prénom de la manière suivante : "rain". Lorsqu'on lui demande pourquoi il n'a pas inscrit le o et le m il explique que le "o" faisant zéro, il annule donc le "m" qui vient après. Nous entendons bien la constellation de sens autour du zéro : l'absence, être nul, etc…, et du "m" qui se dit "aime", qui est aussi une lettre qui se retrouve dans "maman". Nous pouvons penser l'illettrisme dans ce cadre.
Cette aventure spécifiquement humaine qu'est l'écrit, inscrite dans la parole, met en place, comme nous venons de le voir, un type de rapport au monde. Le lien social qui s'organise à partir de là est un effet du mode de saisie du réel que met en place l'écriture.
Les mutations scientifiques et technologiques auxquelles nous sommes confrontés tendent à écraser l'écart entre le symbolique mis en place par nos monothéismes et le réel. Notre subjectivité d'homme moderne voit son espace psychique se réduire et le fantasme apparaît souvent trop vite suspect, et comme en sursis.
Faisons cependant confiance aux capacités d'invention et de subversion de l'écriture pour qu'elle renouvelle nos capacités à maintenir l'écart et le lien entre les choses et leur modalité de représentation.
NOTES
1. Bottéro J.,Mésopotamie L'écriture, la raison et les dieux, NRF, Bibliothèque des Histoires, 1987, P103,104
2. Pommier G., Naissance et renaissance de l'écriture, PUF, Ecriture, 1993
3. Ibid.
4. Ouaknin M.A., Les mystères de l'alphabet, Assouline, 1997, P44.
5 Ibid. P.64