Colloques
Journées d'étude Psychanalyse et Champ Social
- Par LEBRUN J.-P.
Je vais vous parler du livre qu'un romancier belge vient de sortir, que je vous recommande vivement parce qu'il est tout à fait étonnant. Il s'appelle Circuit aux Editions du Seuil et c'est un roman écrit par Charly Delwart. Je vous raconte l'histoire : c'est un monsieur qui n'a plus de boulot, il a une compagne, et il ne se débrouille pas très bien dans l'existence.
Création d'un Département Psychanalyse dans le champ social à l'École Rhône-Alpes d'Etudes freudiennes et lacaniennes
- Par REY SENTENAC F.
Cette journée inaugure la création d'un département à l'Ecole Rhône-Alpes, département qui voudrait donner un accent particulier aux faits sociaux et à ceux qui dans le social œuvrent à maintenir la possibilité du lien social. Cet accent particulier étant pour nous dans la référence au Discours Analytique.
« Nouvelles pratiques sociales » et embarras éducatifs
- Par CANDIAGO P.
Pourquoi des analystes et des éducateurs insistent-ils à conduire un travail en commun ? Ces professions pourraient tout à fait se tenir à l'écart l'une de l'autre et pourtant de longue date, des psychanalystes et des éducateurs tentent de « renouveler » la rencontre entre FREUD et AICHORN. Cette tentative, quoique traversée de malentendus, résiste au temps et aujourd'hui, à l'engouement pour le type de rationalisme qui s'empare du travail social et éducatif.
Les psychanalystes et les éducateurs partagent en commun des métiers ou il n'est pas possible de lier dans une relation causale leur acte professionnel et ses éventuels effets. Le travail éducatif n'est aucunement prédictif de la façon dont il sera reçu par les personnes à qui il s'adresse, ni de ce qu'elles en feront. C'est là, sauf à se vouloir embrigadement, la condition de son exercice.
Le travail éducatif opère ainsi largement à l'insu de ceux qui l'exercent, c'est à ménager une place à cet « insu » qu'il peut venir s'articuler avec le champ psychanalytique, mais cela n'est pas suffisant. Car si les psychanalystes ont élaboré à partir de cette question un solide corpus théorique, les professionnels de l'éducation spécialisée n'ont pas, ou peu opéré ce travail. Nous empruntons nos concepts, parfois de façon échevelée, à différents champs (dont la psychanalyse) et faute d'avoir suffisamment engagé un travail de théorisation, nous nous trouvons aisément emportés par les « questions de société ».
L'OMS définit la santé en ces termes : « Un état de complet bien-être physique, mental et social qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité[1]». Ce complet bien-être relèverait d'une harmonie, d'une absence d'insatisfaction. Mais les sociétés, à l'image de leurs habitants, « évoluent » avec un trouble qui leur semble irrémédiablement attaché ; et l'homme, malgré tous les progrès qu'il a accomplis, reste un animal malade de son humanité.
L'expérience de la conjugalité est exemplaire de cette difficulté, puisque visant cette harmonie, elle est pourtant peu propice à l'expérimentation durable de celle-ci. Pour nous, cette question de la conjugalité est importante, puisqu'après avoir fait le bonheur du théâtre de boulevard, elle est devenue une pourvoyeuse significative des institutions sociales. Les motifs qui amènent nombre de jeunes femmes à solliciter un accueil résident certes dans une absence de domicile, associée à une réelle pauvreté économique. Mais ces traits s'articulent pour l'essentiel à des histoires d'amour qui, loin de favoriser l'établissement d'une vie commune, prennent un tour qui les met à la rue. Ces jeunes femmes témoignent d'une vie où les relations se vivent « à fond », où il y a souvent des coups à prendre et à rendre, et sont prises dans des imbroglios familiaux marqués par une grande confusion de places. Parfois encore ces ruptures masquent des troubles psychiques importants. Pour leurs enfants, qui sont là, au milieu, cela peut avoir des conséquences tout à fait dommageables. Mais à l'exception notable de quelques-unes, j'avancerais qu'elles ne présentent pas les traits d'une très grande désocialisation, tout en témoignant d'une profonde désaffiliation.
C'est par exemple, cette jeune femme qui évoque sa vie avec son compagnon : « C'était l'harmonie, dit-elle, puis petit à petit des contradictions sont apparues ». Il a alors donné son préavis pour l'appartement qu'ils occupaient, puis il est parti dans une autre ville la laissant là, quelque peu sidérée.
Cet exemple, pris parmi bien d'autres, fait apparaître que dans ces couples, la déception inhérente à toute rencontre est davantage enregistrée comme résultant d'un autre qui ne tiendrait pas sa promesse, que comme un effet d'altérité. Ils rendent compte de relations dominées par du « tout », jusqu'à les plonger dans une précarité où s'entremêlent : enjeux sociaux, enjeux affectifs et retentissements psychiques. Que demandent ces jeunes femmes ? Mais d'être « comme tout le monde ».
Mais être comme tout le monde aujourd'hui, n'équivaut pas à être comme tout le monde hier. L'imaginaire social change et il change très vite. La distribution des places d'adulte, d'enfant, d'homme et de femme qui structurait le lien social d'une limite, a cédé le pas à un social où chacun est beaucoup plus libre de revendiquer son accomplissement. La possibilité de choisir son sexe, l'apparition du terme d'adulescence, nous informent que les frontières de genre et de génération sont moins infranchissables que par le passé. A suivre J-P. LEBRUN, dans ce social d'un nouveau type, la soustraction de jouissance nécessaire au vivre ensemble ne va plus de soi[2].
Il me semble nécessaire de considérer que notre travail ne peut se déployer de la même manière dans un social où cette soustraction était acquise, et dans un social où nous ne savons plus très bien si elle tend à se reformuler ou à s'évanouir.
Un point semble assuré, les éducateurs ne disposent plus de cet abri de la tradition qui donnait d'emblée une légitimité à leurs interventions. Cela dit, il n'y a pas nécessairement à regretter des pratiques qui bien souvent se réduisaient à des injonctions morales.
Accueillir ces jeunes femmes dans nos institutions leur procure un abri, c'est un premier pas. Cela leur permet aussi de rencontrer d'autres personnes que leur entourage habituel, de partager avec elles des relations moins abruptes, pour vivre comme le dit J-Y. BROUDIC : « en se faisant un peu moins mal avec l'impossible[3]». Bref, des autres qui permettent que s'inscrive de la « tiercéité ». Mais comment ordonner notre travail pour que cet abri leur soit utile et ne devienne pas une nouvelle impasse ? Cela implique, que pour ces « autres » que sont les professionnels, cette soustraction soit reconnue et acceptée.
Or, la référence à l'insertion est devenue la pierre angulaire du travail d'accompagnement social auprès d'adultes. Cette préoccupation est pertinente, pouvoir élire domicile est essentiel, mais elle est insuffisante, car elle réduit trop souvent ce domicile à la matérialité d'un appartement. Autrement dit, cette préoccupation pour l'insertion (pour les enjeux sociaux) ne doit pas se désolidariser des atermoiements affectifs de ces jeunes femmes, de la façon dont elles essayent de se débrouiller, de demander de l'aide et de la refuser (les enjeux affectifs et psychiques). Un séjour qui se « passe mal », c'est-à-dire qui nous met en difficulté, n'est pas forcément un séjour qui sera sans incidences favorables pour ces personnes et souvent, ce n'est que dans l'après coup que les effets de notre travail se révèleront. La dimension « éducative » du travail d'accompagnement d'adultes, consiste à se présenter comme un appui, pouvant permettre à ces personnes d'assumer leur place de femme, de mère, afin qu'elles puissent cheminer « autrement » et assurer à leur tour, l'éducation de leurs enfants. Cheminement qui n'est pas à assimiler avec une normalisation apparente de leurs comportements et une adhésion à la logique d'insertion.
C'est en cela que notre travail, pour prendre sa dimension « éducative », doit être attentif à laisser s'articuler la rationalité de l'insertion et la rationalité du sujet qui, nous dit C. MELMAN : « Tolère les contradictions, pas du tout gêné de tenir ensemble des formulations parfaitement contradictoires et qui ignore la négation[4]».
Il y a quelques mois, j'ai admis dans mon service une jeune femme que son compagnon avait quittée. Très vite, retranchée dans « sa fierté », elle a transformé son appartement en poubelle, elle nous racontait des histoires abracadabrantes, ne payait rien et faisait des notes de téléphone à faire tomber à la renverse nos services financiers. Toutes nos tentatives pour border l'existence de cette jeune femme se heurtaient à une apparente fin de non-recevoir. Nous étions très inquiets pour sa santé, la question de la protection de sa fille s'est rapidement posée et j'ai été amené à faire un signalement auprès des services de l'Aide Sociale à l'Enfance. Pour autant, bien qu'annonçant sans arrêt son départ imminent, elle s'accrochait à son séjour que nous avons choisi de poursuivre. Cette « fierté », qu'il n'y avait pas à traiter par le mépris, nous avons néanmoins tenté de la faire quelque peu fléchir. Les parents de cette jeune femme se sont courageusement associés à son « accompagnement. A ce jour, sans que nous ne sachions trop pourquoi, nous constatons que quelque chose s'est déplacé pour elle, un effet de « réaffiliation ». Elle est davantage attentive à sa fille, elle commence à « habiter » son appartement et à rembourser ses dettes. Enfin, elle a entrepris une demande pour entrer en CHRS, ce dont elle ne voulait pas entendre parler… Pour travailler avec cette jeune femme, il a fallu que son éducatrice fasse preuve d'une certaine solidité, d'une confiance dans son discernement, mais aussi dans sa hiérarchie, à la condition qu'elle opère comme limite.
Orphelines de cet appui de la tradition, les institutions sociales tentent de construire de nouveaux cadres de référence. Mais la pente sur laquelle elles glissent actuellement désolidarise la logique d'insertion de celle du sujet. Si nous avions fait un contrat avec cette jeune femme, il aurait volé en éclats ; si nous avions respecté à la lettre notre cadre règlementaire, j'aurais dû la mettre dehors. Or, l'acte d'éducation attaché aux pratiques de travail social, vient progressivement se reformuler dans une double préoccupation de proposer les objets adéquats aux besoins constatés et de préciser toujours davantage le cadre et les modalités de son exercice. Autant de modalités qui, par leur inclination pour la congruence, peinent à inscrire ce registre de la soustraction.
Le développement de la notion de « diagnostic social » et des commissions d'admissions, a conduit pas à pas, à une lecture stéréotypée des situations des personnes. L'emploi par exemple du terme de « violence conjugale », au lieu de spécifier la singularité d'une situation donnée, efface tout entendement. Cette stéréotypie se prolonge dans les modes d'accompagnement proposés. Cette orientation se sédimente avec l'apparition des référentiels de bonne pratique et le déploiement de la démarche qualité comme technique d'évaluation. Elle trace la voie d'une uniformisation de nos pratiques dont le caractère procédurier est de plus en plus marqué.
Ces « nouvelles pratiques sociales », dans leur attache à ce rationnel, pour qui l'enchaînement de cause à effet est toujours calculable, se présentent comme un appel à la totalité. En cela, elles tendent à répéter sur un mode institutionnel, les agencements relationnels qui conduisent justement ces femmes à demander un accueil dans nos institutions. Les tentatives de renouer la vie commune sont identifiées comme des échecs. La déprime, les états d'âme, les « crises de nerfs», sont lus comme des signes d'inadaptation, voire comme des atteintes au cadre. Le rappel des règles connaît en effet une inflation remarquable, mais aussi un déplacement, leur caractère d'injonction interdictrice s'estompe au profit d'une prescription persuasive. Suivre ces référentiels semble devoir se faire au prix de notre subjectivité, au prix d'une « non reconnaissance » de la dimension intersubjective de notre travail.
J'ai récemment été entendu dans une brigade de mineurs à propos d'une question de violence conjugale. Nous avions sans doute un peu de temps à perdre et l'inspectrice qui m'a reçu, m'a fait part avec une remarquable sincérité, de son malaise face à ces questions de violence prises dans la passion amoureuse…
« Nous pensions que nous ferions comme avec les enfants, mettre en place des procédures de protection et de poursuite, mais cela ne se passe pas comme ça, ces femmes ne savent pas ce qu'elles veulent, elles nous mentent, elles dénoncent les violences et retournent vivre avec celui qu'elles ont dénoncé. Depuis que nous nous occupons de cette question, on déprime et on s'aigrit. On devient méchant avec ces femmes qu'on se met à haïr ».
Cette inspectrice dans sa difficulté rend compte de l'insuffisance de cette approche rationnelle des questions qui touchent au lien social, au lien amoureux, qui sont bien plus complexes que ce qu'en dit le discours social. Il y a dans ces domaines, nous dit encore J-Y. BROUDIC : « de l'inconnu, de l'innommable, de l'impossible, du mystère, de l'inconscient[5] ». A ne pas ménager une place à cet impossible, c'est bien l'impuissance et parfois la haine qui font retour.
Dans ce contexte, un travail commun entre analystes et éducateurs, s'il devient très improbable, n'en est que plus précieux, ne serait-ce que parce que nous sommes également concernés par la tournure que prend notre lien social qui substitue à la distribution sexuée et générationnelle des places, de nouvelles assignations. Nombres d'éducateurs, bien qu'aspirés par ce mouvement, font entendre leur désorientation et leur insatisfaction face à ces nouvelles techniques éducatives. Un travail en commun peut nous permettre d'ordonner nos pratiques à partir de cette question : selon quelles modalités logiques et alors que la référence au patriarcat n'opère plus, pouvons-nous soutenir cette distribution symbolique des places que les nouvelles pratiques sociales ne semblent pas en mesure de soutenir.
[1] Cette définition de la santé est inscrite dans le préambule de la constitution de l'OMS rédigée en 1946.
[2]J-P. LEBRUN (2007) La perversion ordinaire, Ed DENÖEL, Paris.
[3]J-Y. BROUDIC, L'institution et le sujet
[4]C. MELMAN (1883), Foi religieuse, raison philosophique et rationalité psychanalytique, Librairie La nouvelle édition, BRUXELLE, in Clinique psychanalytique et lien social.
[5]Jean-Yves BROUDIC, ibid.
Le contrat comme symptôme
- Par HAMAMA H.
Je travaille en tant que psychologue à la Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence des Savoie et j'interviens essentiellement au sein d'une structure dont la mission est l'accompagnement éducatif et social de jeunes majeurs ou proche de la majorité, placés soit par décision judiciaire soit par décision administrative.
Je vais essayer de reprendre avec vous la question du contrat, une question qui a déjà été traitée lors des journées à Paris, au mois de mai et intitulées : Le contrat peut-il se substituer à la Loi.
Aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un contrat appelé : "contrat d'accueil et d'intégration". Il s'agit d'un contrat signé par l'étranger nouvel arrivant (également appelé "Primo arrivant") et qui conditionne son accueil sur le territoire français.
Je souhaite aborder ce sujet parce que notre structure éducative a été sollicitée, il y a quelques mois, par la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) pour accueillir un nombre assez important de jeunes, appelés "Jeunes majeurs isolés étrangers".
Je souligne que lors de leur arrivée en France, tous étaient mineurs, ce qui rendait obligatoire l'application de la loi de la protection de l'enfance.
Je ne m'attarderai pas sur les conditions d'arrivée de ces jeunes dans notre structure et des difficultés d'accompagnement que nous avons depuis mais je dois toutefois dire que nous avons été confrontés à une demande pressante d'hébergement de ces jeunes, demande pour laquelle aucun recul n'était possible.
Il faut dire que du fait de leur majorité et de l'application d'un prix de journée différencié entre mineurs et majeurs, les structures d'hébergement classique, type internat éducatif, dans lesquels ils se trouvaient ne pouvaient plus les garder. Nous avons bien sûr l'habitude des demandes urgentes mais à chaque fois avec la possibilité de les prendre en compte sans pour autant répondre dans l'urgence.
Pour revenir au contrat d'accueil et d'intégration, il se base sur l'apprentissage de la langue française comme une formation obligatoire à l'issue de laquelle le candidat passe un examen comportant des épreuves écrites et orales afin d'obtenir le DILF (diplôme initial de langue française).
En cas d'échec à cet examen, le préfet peut mettre fin au contrat puis refuser le renouvellement de la carte temporaire et la délivrance de la carte de résident.
Ainsi, deux questions se posent :
- La première question qui interroge ce contrat est : Quel est le lien entre la dimension de l'accueil et celle de la contractualisation et comment rendre ces deux dimensions compatibles ?
- La deuxième question est : Dès l'instant où ce contrat porte sur la nécessité d'apprendre la langue d'accueil comme condition même de l'intégration, n'y a-t-il pas là, une vision réductrice de cet apprentissage ? Ainsi, l'apprentissage de la langue d'accueil peut-il être opérant sans recours à la manière de dire dans l'autre langue ?
J'espère que mon propos ne sera pas entendu dans une logique binaire, c'est-à-dire d'un coté les méchantes institutions et de l'autre les gentils nouveaux arrivants.
Mon propos est plutôt de prendre en compte ce constat très juste de l'approche par la langue pour savoir si cet apprentissage dans le sens technique du terme peut permettre à l'Autre d'être symboliquement inscrit à la même édification commune, sans renier sa singularité mais en évitant les travers des réflexes narcissiques d'une identité exclusive. Autrement dit, comment traiter un problème de structure qui n'est que notre rapport à l'autre ? Cette réponse du côté du contrat peut-elle assigner les nouveaux arrivants à l'ordre du désir et non à celui du besoin et de la jouissance ?
En effet, on assiste depuis environ une quinzaine d'années à un développement des procédures contractuelles en tant que nouveau mode d'action des différentes autorités publiques, et ce dans de nombreux domaines et à de multiples niveaux.
Ce phénomène de prolifération renvoie directement à ce qu'il est convenu d'appeler la nouvelle gestion publique. L'idée communément répandue aujourd'hui est que le contrat favorise dans les faits une plus grande souplesse de l'action publique, qu'il permet de l'adapter en quelque sorte au besoin spécifique du terrain et surtout qu'il améliore la qualité de service des organismes.
Force est de constater que pour les institutions aujourd'hui, le contrat est devenu un horizon indépassable, un cadre incontournable, ne serait-ce que parce qu'il est la condition sine qua non du financement de nombreuses actions et dispositifs. Rien n'interdit de voir dans le développement de la contractualisation la traduction procédurale d'une conception de plus en plus libérale de l'action publique, calquée sur la gestion telle qu'elle existe dans le domaine industriel. Tout un vocabulaire qui fait désormais figure de véritables normes administratives communes. En ce sens donc, le contrat est le symptôme d'un certain nombre de changements profonds.
A ce propos, dans le département de la Savoie, à partir de l'année prochaine, toutes les institutions éducatives et sociales seront obligées de signer un COM, c'est-à-dire un contrat d'objectifs et de moyens. Ce contrat sera négocié avec les institutions sur la base d'un référentiel rédigé par le Conseil Général avec lequel la PJJ s'est associée.
Ce référentiel nous indique que l'accompagnement, par exemple, celui des jeunes majeurs, ne se fera que pendant six mois renouvelables éventuellement une fois.
De plus, cet accompagnement devra se faire sur la base de deux heures par semaine et par jeune. Autrement dit, pour continuer à fonctionner, deux solutions s'offriront à l'institution, licencier ou augmenter sa capacité d'accueil c'est-à-dire faire le choix du quantitatif.
Revenons à ce contrat d'accueil et d'intégration dans lequel il y a le mot "accueil". Ici, c'est l'accueil qui soumet l'accueilli à un contrat définissant et réglant les modalités de son arrivée, son séjour et son éventuel départ.
L'accueil contracté fait l'objet d'une rationalisation et d'une professionnalisation croissante et ressort de ce fait de plus en plus largement de logiques utilitaristes et pragmatiques. Distance donc qui sépare cet accueil contractuel et un accueil qu'on pourrait appeler hospitalier (la loi de l'hospitalité précède le contrat qui, lui, procède d'autres lois).
En dépit de ces bonnes intentions de bien accueillir le nouvel arrivant, le contrat d'accueil et d'intégration s'apparente à cet accueil bureaucratique et antinomique d'hospitalité. L'accueilli, une fois pris dans les rets juridiques de ce contrat, se trouve dans une position inconfortable. L'exécution du contrat est sujette à toutes sortes d'incertitudes : accueil sursitaire tout fourchu de conditions (évaluation, validation, certification, attestation, sanction, diagnostic, repérage social, contrôle sanitaire, suivi administratif, mise au point, bilan, etc.) qui accompagnent ce terme dans le dit contrat. On est loin de l'accueil qui consiste à recueillir sans jauger ni juger.
Il faut aussi dire que ce contrat ne boude pas les mots généreux comme offrir, recevoir, permettre, former, accorder.
En effet, dans ce contrat, la maîtrise de la langue d'accueil est posée comme un des préalables à l'intégration de la personne accueillie. L'acquisition d'un titre de séjour durable exige l'épreuve du seuil linguistique, rite de passage obligé qui s'éprouverait à travers un stage préliminaire et éliminatoire.
Apprendre une langue suffit-il pour conclure à la réussite de l'accueil et parler d'intégration ? La question linguistique qui nous intéresse ici, commence là : pour un homme, partir dans un autre pays, ce n'est pas seulement changer de pays et parler une autre langue, c'est aussi changer de place dans sa propre parole. Ce changement ne va pas sans embarras pour le sujet.
Si on se réfère aux hypothèses de Charles Melman concernant les effets subjectifs de la migration linguistique, retenons deux hypothèses :
· La première hypothèse s'applique à une femme qui, dans la mesure où elle a déjà connu une forme de première migration, celle d'émigrer de l'Autre côté pour devenir femme, est plus apte à supporter la situation d'immigration.
· La seconde hypothèse concerne un homme. Pour lui, changer de langue le met dans la position d'un faire semblant qui le ramènera du côté Autre, donc pas à sa place. Cette migration que l'on peut qualifier de migration forcée, si elle est acceptée, peut ainsi être vécue comme une féminisation.
Dans la situation qui nous intéresse aujourd'hui, l'étranger ne se présente pas comme un infans, comme quelqu'un qui ne sait pas encore parler mais comme quelqu'un qui parle autrement. L'étranger n'est pas quelqu'un dans l'impossibilité de parler mais dans l'impossibilité de traduire, de se traduire. Si l'étranger aspire à habiter la langue d'accueil, c'est à partir d'une langue première qui l'habite et qui définit son "étrangéité" même.
La nécessité de prendre en compte cette première langue est due au fait qu'elle n'est jamais un simple outil de communication. C'est par la langue maternelle que passent tous les processus de traduction consciente et inconsciente des évènements de la vie psychique.
Pour la psychanalyse, l'important est moins la langue que l'on parle que celle au travers de laquelle "on a été parlé". Le sujet humain est parlé avant même de parler lui-même et quand il se met à le faire c'est à partir de cet immense discours déjà tenu à son propos.
D'où l'importance de penser l'accueil linguistique autrement que comme un apprentissage fonctionnel de la langue d'accueil. Certes, apprendre la langue d'accueil est précieux à condition peut-être que celle-ci s'ouvre à la langue de l'autre, en permettant la circulation des manières de dire d'une langue à l'autre. Il est donc nécessaire que l'autre langue, la langue maternelle garde une valeur d'échange. L'accueilli a besoin de donner sa langue à l'autre, la greffer sur l'autre langue pour se retrouver.
Tout l'enjeu pour le nouvel arrivant est de s'approprier son parcours, de construire ses modes de dire dans une autre langue. En excluant cette possibilité, la langue d'accueil se réduit à un outil, à un instrument puisque l'objectif est de permettre l'insertion sociale et le plus possible d'ouvrir la voie vers l'insertion professionnelle par l'accès aux formations qualifiantes, autrement dit d'accéder au marché de l'emploi. Donc, point d'altérité hors le marché.
Deux exemples :
1. Il m'est arrivé d'entendre lorsque des jeunes se croisent dans notre service et échangent dans leur langue d'origine la remarque suivante de certains collègues : "ici on parle français"
Cet impératif m'a interrogé et m'a rappelé le cas de collègues qui lorsqu'ils assistent à la conférence d'un psychanalyste se demandent, par crainte de ne pas comprendre si ce dernier parle bien français. Crainte qui peut être lue comme celle d'être délogé de sa place.
2. Il s'agit d'un jeune de 17 ans ayant toujours vécu en Algérie jusqu'à ses seize ans. Pendant son accompagnement par notre structure, l'équipe éducative a rencontré de nombreuses difficultés à lui imposer les cours d'apprentissage de la langue. Il refusait de participer disant « que ça ne servait à rien et qu'en plus il n'y avait que des vieilles femmes ».
En m'intéressant à la difficulté de ce jeune, j'ai pu constater que malgré sa scolarisation en Algérie, il n'avait pas acquis les bases de la langue arabe classique. De même que pour la langue française, l'alphabet n'était pas acquis. En revanche, ce jeune avait appris rapidement à manier un langage de "quartier" et la question dans sa difficulté était de savoir ce qu'il ne voulait pas quitter et en quoi ce "parler quartier" pouvait inscrire pour lui une position sexuée ?
Ce qui nous est renvoyé dans ces "prises en charges" est surtout une problématique de la rupture, rupture avec les siens, avec son pays, avec sa langue. Et cette rupture a des conséquences. Vivre ailleurs oblige de passer par la confrontation à la question du lieu, à celle du domicile et à celle de la patrie.
Cette confrontation à un exil réel peut amener l'exilé à refouler l'exil de structure auquel on a tous affaire. Un exil du côté du traumatisme qui empêche de prendre en compte l'exil de structure. Dans ce cas, l'accueillant ne peut entendre cette histoire-là que s'il a lui-même pris en compte l'exil de structure et c'est cette prise en compte qui permettra à l'exilé de ne pas se fixer sur son traumatisme. Cette rencontre n'est possible que dans une parole qui soit un pacte, rencontre qui ne pourra pas être contractualisée mais qui permettra à chacun de prendre la mesure que nous sommes tous bilingues.
Le contrat vient confirmer le symptôme dans lequel on se trouve et qui consiste pour les exilés à confondre jouissance et désir (résister à l'apprentissage de la langue et être uniquement dans le besoin et dans les avantages) et pour les accueillants à confondre l'accueil et l'aide.
Partir est souvent un acte, acte de partir ailleurs, accompagné très souvent d'une immense culpabilité, comme s'il s'agissait d'une transgression, voire d'une trahison. Assumer cet acte dépend de la façon dont le sujet vit son déplacement, la façon dont il parvient avec ses ressources psychiques à surmonter les effets de la rupture.
Ainsi, pour que l'intégration inscrite dans ce contrat puisse être efficace, quelle place est réservée à l'altérité ?
En nous référant au Discours du Maître qui organise notre social, un discours organisant une solidarité entre S1 et S2 et visant l'altérité doit maintenir un juste écart entre ceux qui commandent et ceux qui sont commandés, écart nécessaire pour que l'autre soit reconnu et surtout pris en compte dans le discours sans que la place de ceux qui commandent soit délégitimée.
Car la demande de ces "jeunes étrangers" est une demande de reconnaissance, d'être tout de même des semblables, autres mais de même nature, des semblables parce que différents.
Séminaire d'été 2007 - L'envers de la psychanalyse - Discours, jouissance et inconscient
- Par AREL P.
Nous avons eu cette année la chance de pouvoir lire ce séminaire extraordinaire, et dans le même temps de suivre un événement politique attendu depuis longtemps dans notre pays, les élections présidentielles. Cela a été pour nous l'occasion de pouvoir suivre au jour le jour la vie politique qui évolue de plus en plus vite selon des voies difficiles à interpréter, mais témoigne d'une mutation du discours du maître dont nous pouvons nous demander quelle incidence elle peut avoir sur notre jouissance et par voie de conséquence sur notre inconscient. Malgré ces difficultés ce séminaire en permet la lecture, selon une articulation qui reste d'une grande actualité presque quarante ans après. Nous pouvons même être étonnés du repérage, par Lacan, des signifiants qui était déjà aux commandes dans le domaine politique à cette époque là. Comme il le dit dans D'une réforme dans le trou, « Pour s'y retrouver il faut savoir que le présent est contingent, comme le passé est futile. C'est du futur qu'il faut tenir que le présent tient ce qu'il a de nécessaire. Le vainqueur inconnu de demain, c'est dès aujourd'hui qu'il commande. »
Voilà qui est congruent avec la tâche dévolue au discours psychanalytique, à savoir de produire, par le truchement de l'interprétation, l'extraction de ce produit particulier qu'est le contenu latent, le signifiant maître qui était caché dans le contenu manifeste du mythe qui anime le discours du maître.
Avec ces signifiants nous pouvons suivre une mutation du discours du maître et donc du politique qui a été particulièrement sensible au niveau de la campagne présidentielle. Cette campagne, très suivie, nous a permis d'une certaine façon de faire le point, de préciser où nous en sommes, du fait qu'elle a apporté avec elle quelques éléments de nouveauté, fort attendus après une longue période politique qui a été vécue comme une période d'indécision et de stase, voire d'impuissance.
Cette campagne est arrivée sur un fond d'inquiétudes nouvelles nées de la persistance voire de l'aggravation de difficultés qui touchent le travail, l'économie et le lien social. Je prendrai pour indice de ces inquiétudes un constat qui a été fait à maintes reprises, et qui peut paraître marginal, à savoir qu'il s'est dit pour la première fois depuis bien longtemps que la nouvelle génération allait connaître des conditions de vie plus difficiles que celles de ses parents. C'est la première fois depuis des lustres, puisque nombre d'entre nous ont pu entendre leurs parents dire qu'ils souhaitaient que leurs enfants soient plus heureux qu'eux, promesse qui s'est transmise de génération en génération, autant dans les familles que les écoles, depuis le siècle des lumières.
Dire que la génération actuelle connaît une dégradation de ses conditions de vie, c'est à la fois mettre en doute la promesse de progrès qui nous a été transmise très largement, et repérer une perte et une entropie là même où était attendue une récupération de la jouissance perdue de génération en génération. Puisque l'espoir du prolétaire, lui qui chez les romains était qualifié de juste bon à faire des enfants — proles — , son espoir donc a surtout été que ses enfants réussissent dans la vie, qu'ils soient reconnus à leur juste valeur et qu'ils leur reviennent une part de ce plus de jouir qu'ils ont dû céder. C'est autour de cette inquiétude concernant la nouvelle génération, qui par ailleurs renvoie les signes d'un malaise bien installé, tant dans son rapport au travail que dans les modalités de jouissance de ses loisirs, qu'un certain nombre de thèmes de la campagne présidentielle se sont organisés . Et là nous pouvons dire que si l'inquiétude est justifiée et le diagnostic du malaise bien posé, les remèdes proposés nous paraissent non seulement inappropriés, mais également participer du problème. En effet nous assistons en permanence à une alternance de discours compassionnels adressés à des supposées victimes des abus ou des carences de telle ou telle partie du corps social, à qui l'on promet une plus juste répartition des moyens mis à leur disposition pour leur permettre l'accès à la réussite sociale, avec des discours d'une rare sévérité à l'égard des contrevenants aux règles supposées assurer le bien public. Ces discours participent les uns et les autres à l'édification d'un surmoi colossal qui prescrit tout autant l'interdiction de la jouissance que la prescription de cette même jouissance, optimalisée, lequel surmoi est placé sous l'égide d'un Autre qui lui-même jouit à pleins tuyaux : le peuple. Ajoutons que ce surmoi se donne les moyens scientifiques d'arriver à ses fins : l'évaluation, qui fut un des signifiants-maître de cette campagne présidentielle. Tous les jours nous avons entendu, et nous entendons encore, les mots : évaluation, chiffrage, politique basée sur les preuves, et leur cortège de ségrégation : ceux, ministres et président compris, qui n'ont pas une bonne évaluation, à la porte !
Exacerbation donc du recours à l'évaluation, et par conséquent à la tentative de récupérer la plus-value perdue, par un appel à la science qui offre désormais des moyens techniques à la spoliation du savoir de l'esclave par le maître, esclave dont le corps doit se soumettre à la taylorisation de tâches de plus en plus sophistiquées. C'est ce qui s'est passé ces dernières décennies dans le champ de l'industrie et des services, et arrive même aujourd'hui dans le champ de l'éducation et de la médecine, psychiatrie comprise, par la médecine basée sur les preuves. Ce que cette protocolisation des procédures de soins vient nous faire oublier, c'est qu'au-delà de la lésion, les patients pâtissent de la jouissance que le langage exacerbe dans leur corps. En somme plus nous élevons haut la digue de l'évaluation contre le Pacifique de la jouissance corporelle, et plus cette digue fait eau de toute part, laissant ruisseler cette jouissance par tous les interstices du corps social.
Ce barrage, malgré ses fuites, installe une frontière dont le séminaire de Lacan vient esquisser les contours. C'est sur le fond du savoir qui est la jouissance de l'Autre que le S1, le signifiant-maître intervient sur l'un des signifiants de ce savoir, ce qui a pour effet le surgissement de $, le sujet. Cette opération occasionne une perte de jouissance. Il y a ainsi une jouissance initiale, qui est un savoir qui ne se sait pas, dont une partie est prise sous l'effet du signifiant-maître, ce qui permet un comptage de cette jouissance, comptage dont les comptes ne tombent jamais juste du fait de la déperdition de jouissance. Une partie de la jouissance reste hors discours, et donc hors comptage, hors savoir, ce qui la rend hypothétique, comme la jouissance des lys des champs qui ne tissent ni ne filent, mais doit être gardée comme hypothèse si l'on veut considérer ce sur quoi les discours opèrent.
Cette distinction entre une jouissance prise dans la ronde des discours et une jouissance hors discours, nous la trouvons par exemple, pour suivre les effets du nouveau discours du maître sur la jeune génération, articulée dans un article d'un grand intérêt, paru dans La clinique lacanienne sur « Les nouveaux rapports à l'enfant », intitulé « L'enfant dieu chez Savitkaya », de Laurent et Christian Demoulin. Nous trouvons dans cet article la distinction entre l'enfant roi, « his majesty the baby » tel que Freud en parle dans Pour introduire le narcissisme, et l'enfant dieu tel qu'ils le repèrent dans les récits autobiographiques de l'écrivain contemporain Savitzkaya. L'enfant roi est un enfant célébré, magnifié, pour autant qu'il est pris dans un discours qui tient au fait qu'un trait symbolique lui a été attribué, qui le fait entrer dans la reconnaissance phallique. Par l'attribution de ce trait unaire, inconscient, l'enfant est pris dans un réseau d'obligations et dans une temporalité qui est aussi bien la temporalité du travail que celle des générations qui se succèdent. L'enfant roi a ainsi trouvé sa couronne du côté du symbolique.
Celui qu'ils nomment l'enfant dieu, sans majuscule, trouve son autorité du côté du réel, du fait qu'il est un enfant qui n'est pris dans aucune contrainte symbolique ; ses relations à l'autre sont seulement tributaires des aléas de sa demande, et jamais soumises à la moindre condition symbolique. L'enfant dieu est ainsi hors relation de travail, et hors filiation. Il est, tout simplement. Ce qui fait dire aux auteurs qu'il est, comme les dieux, réel, totalement énigmatique. On peut décrire son action, sans la comprendre. Il est au-delà de l'imaginaire et du symbolique, dans le registre de la pure présence. « Savitzkaya nous décrit un rapport à l'enfant qui serait hors discours, tout au moins hors des discours institués, ou plutôt une tentative de réinventer un discours d'avant le discours du maître, un discours mythique où il n'y a ni père ni fils mais des géants et des nains, dans un temps suspendu. »
C'est sur cette distinction entre une jouissance prise dans la ronde des discours et une jouissance hypothétique, innommable, mais déductible, que je vais me rapprocher du texte de ce séminaire. Lacan y articule les rapports du signifiant à la jouissance dans les discours qui distribuent les places autant dans le politique que dans la sexuation.
C'est ce que nous rencontrons dès la première leçon, qui s'ouvre sur la genèse du sujet, à savoir ce qui se passe quand un signifiant intervient dans le champ des autres signifiants. Cette phrase, si souvent répétée, un signifiant, c'est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant, prend ici un tour différent dès lors que cet autre signifiant est assimilé à S2, le savoir, et que ce S2 a un rapport primitif à la jouissance. « Etc'est pour autant que S1 ayant surgi, premier temps, se répète auprès de S2, d'où surgit dans l'entrée en rapport le sujet, que quelque chose représente une certaine perte. » C'est sur cette perte que se dialectise la frustration et vient se placer cet objet autour duquel se met en fonction le désir, le plus de jouir. A quoi Lacan ajoute que cette formule du signifiant qui représente un sujet pour un autre signifiant, ce que l'on peut écrire :
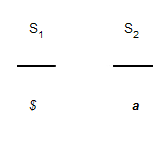
c'est l'écriture du discours du maître.
D'emblée, dès la première leçon, Lacan pose ce coup de force du discours du maître qui, par le surgissement d'un signifiant-maître, impose une perte au savoir qui a ce rapport primitif à la jouissance. Ce qui a des effets sur le savoir, puisque celui de l'esclave lui est amputé dans l'opération, sans que pour autant le maître désire en savoir plus. Ce temps premier, qui va se poursuivre par des spoliations, des soustractions à l'esclave de son savoir au bénéfice du maître qui le capitalise, Lacan en parle en termes historiques, comme d'une longue évolution historique qui nous fait passer d'un discours du maître ancien à un discours du maître moderne, avant d'en faire une écriture logique et d'avancer que le maître est une fiction et finalement un opérateur logique.
Il y a une opération, qui est cette entrée dans la ronde des discours, dont Lacan précise dans les leçons suivantes la portée. Dans la leçon du 14 janvier, il est question d'un effet de discours qui est effet de rejet, ce que Freud a découvert en s'intéressant à la répétition. Ce qui nécessite la répétition, c'est la jouissance. Dans la répétition, il y a déperdition de jouissance. C'est de là que prend origine la fonction de l'objet perdu. L'identification de la jouissance qui en résulte tient à la fonction du trait unaire. « C'est du trait unaire que prend son origine tout ce qui nous intéresse, nous analystes, comme savoir. » Le trait unaire est moyen de la jouissance qui dépasse les limites du plaisir. Mais à la place de cette perte introduite par la répétition, nous voyons surgir la fonction de l'objet perdu, l'objet a. Ce qui fait que là où le trait unaire impose un travail au savoir, le savoir va produire une entropie. Il y a de l'entropie, comme nous le constatons à notre époque qui souffre de réchauffement climatique. Tous les jours nous entendons parler de cette surchauffe de la planète qui est la surchauffe de la jouissance produite par le prolétariat qui prolifère. Que fait le maître ? Il peut certes interdire la jouissance et il ne s'en prive pas, mais il appelle à un surcroît de travail pour rattraper cette perte de jouissance, ce qui occasionne un échauffement supplémentaire. Il voudrait faire du monde un jardin à la française, et il assiste impuissant à la production de mégapoles ingérables en déficit permanent d'urbanisme, de voirie, d'assainissement.
Cela n'empêche pas l'esclave de continuer à mettre son savoir, et sa jouissance, dans les traces du trait unaire et premier. Bien au contraire, et par la même occasion cela nous livre la vérité du maître qui est sa faiblesse, qui reste à cacher. C'est pour cette faiblesse qu'on va l'aimer, le maître. On va lui donner ce qu'on n'a pas pour venir au secours de sa faiblesse originelle. Ce n'est pas la dernière campagne présidentielle, où les appels à l'amour ont été nombreux et répétés, qui peut démentir ce point.
Dans la leçon du 21 janvier, Lacan fait une remarque annexe qui prend son importance dans les leçons suivantes Cette remarque concerne les femmes : elles sont moins enfermées que leurs partenaires dans le cycle des discours, même si elles peuvent avoir une culture des discours, comme les hystériques. Alors que l'homme, le mâle, le viril, est une création de discours.
La leçon du 11 février s'ouvre sur la jouissance féminine, question à risque que Freud a abandonné. « La jouissance, ça commence à la chatouille et ça finit à la flambée d'essence. » De la jouissance féminine, Lacan distingue très précisément la jouissance phallique. Il n'y a que le phallus à être heureux, pas le porteur. C'est autour de lui que tout le jeu tourne, lui dont on peut isoler la jouissance qui est soumise à la finitude. Son organe est soumis à la tumescence et la détumescence.
De cette jouissance qui connaît la finitude et même l'interdit, nous avons dans l'expérience analytique à distinguer le plus de jouir dont la fonction est de suppléer à l'interdit de la jouissance phallique, et donc au manque, au désir. C'est la finitude de la jouissance phallique qui introduit au manque.
Mais comment peut-on désirer quoi que ce soit ? « Quelqu'un a dit : rien ne manque ! Regardez les lys des champs, ils ne tissent ni ne filent. C'est eux qui sont à leur place dans le royaume des cieux. » Ce « rien ne manque » vient situer les lys des champs dans le réel, qui est le seul à ne manquer de rien, comme l'enfant dieu de Savitkaya. D'ailleurs, Lacan ajoute que « le lys des champs nous pouvons l'imaginer comme un corps tout entier livré à la jouissance…C'est peut-être une douleur infinie d'être une plante. »
C'est me semble-t-il ce que Lacan peut nous dire de plus précis dans ce séminaire sur ce que pourrait être une jouissance hors discours. A quoi il ajoute qu'il y a un moins de jouissance, c'est-à-dire un principe de plaisir, qui existe déjà chez l'animal. C'est précisément ce qui renforce l'énigme de l'inconscient dans lequel se rencontre la répétition, l'au-delà du principe de plaisir. La répétition, c'est la dénotation précise d'un trait, trait unaire, bâton, en tant qu'il commémore une irruption de jouissance.
Ces éléments introduisent à un passage, p.94, qui situe la différence de rapport au discours et à la jouissance pour les hommes et pour les femmes. Il dit qu'il y a « une dominance de la femme en tant que mère, mère qui dit, mère à qui l'on demande, mère qui ordonne…La mère donne à la jouissance d'oser le masque de la répétition…elle apprend à son petit à parader. Elle porte vers le plus de jouir parce qu'elle plonge ses racines, elle, la femme, comme la fleur, dans la jouissance elle-même. Les moyens de la jouissance sont ouverts, au principe de ceci qu'il ait renoncé à la jouissance close et étrangère à la mère.» Peut-on dire qu'il n'y a expérience de la répétition commémorée par le trait unaire que parce que la mère, qui n'a pas été civilisée totalement par le discours, produit ce plus de jouir, cet excès de jouissance qui va donner à sa progéniture les moyens de se soutenir dans la vie ? C'est ce qui semble, et Lacan ajoute même que c'est de là que se fonde ce qu'il appelle « la sexuation de la différence organique », qui implique « l'exclusion de l'organe spécifiquement mâle. Le mâle dès lors est, et n'est pas ce qu'il est au regard de la jouissance. Et de là aussi, la femme se produit comme objet, justement de n'être pas ce qu'il est d'une part — différence sexuelle — et d'autre part d'être ce à quoi il renonce comme jouissance. » Phrase bien difficile à lire, qui nous livre qu'une femme n'est objet pour un homme que d'échapper à la condition de son partenaire dans les discours, et à garder un contact avec la jouissance à laquelle il a dû renoncer.
Dans la suite immédiate de ce passage, Lacan avance que ces remarques sont essentielles pour poser la question de la place de la psychanalyse dans la politique. « L'intrusion dans la politique ne peut se faire qu'à reconnaître qu'il n'y a discours, et pas seulement analytique, de discours que de la jouissance. »
Voilà qui est à garder en mémoire pour aborder la leçon du 18 février où Lacan dit que l'Urverdrängung est un fait politiquement définissable. Dans cette leçon, il est question de la prééminence du discours du maître, qui enserre tout, même dans la révolution. Le discours n'a qu'un contrepoint, le discours de l'analyste, qui seul s'occupe des effets du discours du maître que sont la séparation S1-S2, la faille du sujet, la chute de l'objet a, et la castration. Le discours du maître est politique de ce qu'il vient séparer le signifiant-maître des moyens de la jouissance que constitue le savoir. Et Lacan insiste pour revenir sur ce temps premier logique du surgissement de S1 sur le savoir. « Assurément, au départ, il n'y en a pas (de signifiant-maître), tous les signifiants s'équivalent en quelque sorte, pour ne jouer que sur la différence de chacun à tous les autres, de n'être pas les autres signifiants. C'est aussi par là que chacun est capable de venir en position de signifiant-maître », et de représenter un sujet pour un autre signifiant.
Ce passage est d'une grande importance pour rendre compte de ce qui se passe dans la clinique, et aussi dans le champ politique.
Dans la clinique, nous n'avons pas fini de nous interroger sur ce temps premier, temps logique, à partir duquel S1 et S2 se distinguent. Et pour avancer sur cette question, nous avons intérêt à aller voir du côté de la clinique où S1 et S2 ne se sont pas séparés, et sont restés en continuité. Les agencements cliniques, nombreux, nous les nommons symphyse, collapsus S1-S2, ou encore holophrase, terme que nous employons surtout pour la psychosomatique, mais qui pourrait s'appliquer finalement à d'autres structures cliniques, comme le fait remarquer M. Czermak dans son texte A propos de la psychosomatique. Il propose quatre conjonctures au cours desquelles celui qui en est l'hôte ne peut répondre avec un autre signifiant pour un signifiant qui lui fait défaut, ce qui fait qu'au lieu de répondre dans le symbolique, ça répond dans le réel. Ces quatre situations, ces quatre conjonctures sont l'angoisse, l'hallucination, le passage à l'acte et la psychosomatique, à quoi M. Czermak ajoute le refoulement originaire. Le refoulement originaire n'est pas un refoulé, mais une forclusion. Le représentant psychique qui a disparu dans le refoulement originaire n'aura pas de représentant dans le symbolique ultérieurement. C'est là un impossible, au même titre que l'impossible qui existe dans chaque discours.
Cet impossible qui est attaché à la symphyse S1-S2 a une conséquence immédiate concernant la psychanalyse, qui est que s'il n'y a pas de représentant de la représentation, il n'y a pas d'interprétation possible, de dégagement possible du contenu latent, du S1 en place de produit. Ceci revient à dire que s'il n'y a pas d'inconscient, qui est un savoir disjoint qui a un pied dans le mythe et un pied dans la science, il n'y a pas d'analyse possible. Pour qu'il y ait de l'analyse et de l'interprétation, il faut qu'il y ait une prise dans la ronde des discours, ce qui implique qu'il y ait de l'inconscient. Et pour cela, il y faut un fait politique qui est l'institution du discours du maître.
Et justement, au niveau politique, cela change à grande vitesse ; si bien que nous pouvons nous demander ce que devient le discours du maître aujourd'hui. Mon intuition, qui reste à démontrer, est que les conditions d'accès au discours, et donc au désir mâle, viril, et à l'inconscient, sont rendus plus difficiles du fait que nous avons affaire de plus en plus à un maître qui est le nouveau riche, c'est-à-dire l'esclave qui passe son temps à se racheter. Celui-ci n'a pas renoncé à la jouissance corporelle qui fit sa condition d'esclave, et ce maître là ne peut pas assurer à une femme la place originale qui est la sienne dans la ronde des discours. D'où les beaux jours qui s'annoncent pour le discours hystérique qui est loin d'avoir perdu de sa virulence, y compris et même surtout dans le domaine politique. L'hystérie collective reprend de la vigueur, comme dans toutes les grandes périodes d'anomie de notre histoire. Ne serait-ce pas du côté du discours hystérique, qui prône la production forcenée de savoir, qu'il faudrait chercher ce goût prononcé pour l'évaluation, la traçabilité et la transparence ? Il faut que ça se sache, que ça produise du savoir qui soit reconnu par le grand Un. Face à un maître qui ne propose comme réponse à la dénonciation par l'hystérique de ce qui ne va pas que la réparation, l'indemnisation, voire la production de lois nouvelles censées prévenir la survenue ultérieure du problème, de l'accident, l'hystérique n'a d'autre possibilité que de s'enfermer dans sa demande, sa revendication, et s'éloigner chaque jour un peu plus de la dialectique du désir, et donc de la ronde des discours. Si le maître moderne est ce maître qui répond dans l'immédiateté à la demande, en quoi il prend la place de la mère, il est celui qui aggrave les difficultés d'accès à la ronde des discours, et donc à l'interprétation, c'est-à-dire au désir — le désir c'est son interprétation- et il aggrave par là même les phénomènes de ségrégation.
Pour la psychanalyse et les psychanalystes, les enjeux sont considérables, puisqu'ils sont d'une part de repérer et de maintenir, quand elles existent, les conditions d'accès à la ronde des discours, c'est-à-dire les conditions opératoires du discours de l'analyste, et d'autre part d'ores et déjà de tenter de rendre compte de ces divers phénomènes de ségrégation, qui sont autant d'exclusions de la ronde des discours, et des possibilités qui existent qui existent de venir raccrocher ses wagons aux discours en circulation.
Cela suppose, pour réaliser cette tâche, de ne prendre aucun discours pour un idéal de discours, ni de prendre la situation hors-discours pour une anomalie. Le refoulement originaire en tant qu'il est une forclusion, n'est pas une anomalie, mais c'est semble-t-il ce contre quoi nous nous défendons le plus, au risque de la ségrégation.